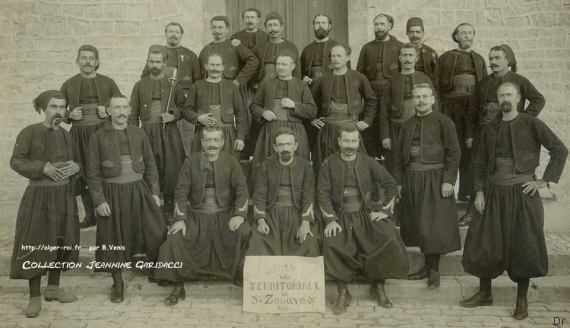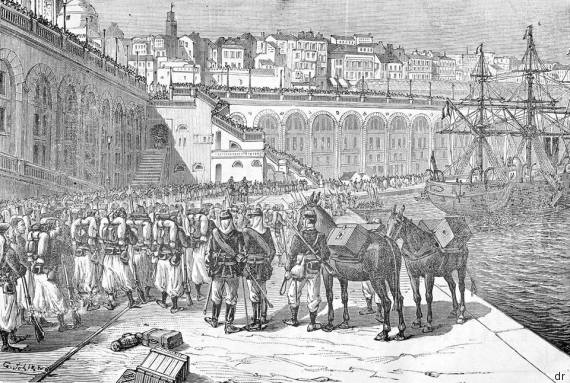L'inquiétude est palpable en Tunisie chez tout le monde: les politiques, les milieux d'affaires, la société civile, les professionnels et chez l'homme de la rue.
Jamais la confiance dans la classe politique et les partis n'a été aussi faible.
Tout le monde s'accorde à dire que le pays manque de leadership politique, certains l'expliquent par le régime politique de la 2eme république et appellent à une révision de la Constitution et chacun selon ses préférences.
Pourquoi n'avançons nous pas? Pourquoi l'impression générale est à l'immobilisme et que rien n'avance? Pourquoi n'arrive t-on pas à réformer le pays et à l'engager dans la voie du progrès et de la justice sociale? Pourquoi l'opinion publique tunisienne est déçue par la révolution et même par la démocratie? Pourquoi n'arrive t-on pas à insuffler l'espoir et la brise du changement? Pourquoi il n'y a pas de vrai débat politique sur les questions de fond?
Autant de questions qui expliquent ce mal-être général dans le pays tant au niveau de l'opinion publique que des classes politiques ou les élites en général.
Après cinq ans d'une "révolution" de plus en plus remise en cause, il est temps de nous regarder en face tels que nous sommes et pas tels que nous souhaitons qu'on soit et de poser franchement les raisons des blocages sur la table et d'en discuter sans agressivité, sans arrière pensées politiciennes pour le bien de notre pays et pour le succès de notre transition démocratique.
La Tunisie est un homme malade... pour emprunter l'expression de Nicolas 1er à propos d'un empire ou plus rien n'allait plus.
La Tunisie, cet État malade que nous n'arrivons pas à instaurer, et dont la construction d'ailleurs n'a jamais pu être achevée. (Et c'est autre débat tout aussi important).
L'homme malade n'a ni la force d'insuffler le changement et de donner la direction, ni d'imposer la force de la loi à tous. Et il est au même moment sujet aux convoitises de ses sujets pour se disputer ses attributs et son pouvoir.
Dans cette guerre pour le pouvoir ou ses attributs, l'intérêt du pays est en général le dernier souci des protagonistes soucieux d'avoir la plus grosse part du gâteau pour servir leurs intérêts propres.
Dans ce climat, les questions de fond ne sont jamais soulevées. Il n'y a que des polémiques stériles destinées à affaiblir un adversaire, et jamais un débat d'union autour de ce qui est communément appelé "l'intérêt général".
Le débat est nécessaire. Un débat franc sans langue de bois, sans faux fuyants.
Un débat constructif afin d'explorer les raisons qui font que cet homme soit si malade et afin surtout d'explorer les pistes de sortie de crise.
J'ai recensé cinq forces principales qui tiennent l'homme malade en otage:
1. L'administration tunisienne, ce "big brother"
On dit beaucoup de bien en général de notre administration, sa compétence, sa loyauté, mais on parle rarement de ses travers, populisme oblige.
Oui nous avons la chance d'avoir la tradition d'une bonne administration loyale et compétente mais en contrepartie cette administration tient le pays d'une main de fer, elle régente tout, a un œil sur tout, règlemente tout et ne veut pas lâcher une once de son pouvoir.
Habituée à diriger le pays à travers les seuls ministres issus de ses rangs (à quelques rares exceptions près), elle a du mal à accepter le leadership "politique" de ministres venus d'autres horizons -qui pour certains ne sont pas à la hauteur de la tâche assumons-le- .
L'administration a perdu beaucoup de son rayonnement et de sa compétence mais pas de sa loyauté envers l'État et le pays.
Les différents corps de métiers se mettent en mode "défense d'intérêts" et refusent tout changement et toute remise en cause.
L'erreur est de désavouer le "politique", de le diaboliser même au détriment de ce qu'on va appeler les indépendants ou technocrates.
L'approche est totalement fausse car dans toute démocratie, le projet est politique avant tout et doit être mené par des politiques, c'est leur responsabilité qui est engagée devant le peuple qui est le seul à les sanctionner par rapport à ses attentes.
En bref, un gouvernement gouverne et une administration exécute.
2. L'ARP, ce détenteur d'un pouvoir qui se veut absolu
Nous avons voté une Constitution consensuelle qui définit les prérogatives de chaque pouvoir et qui a distribué entre le pouvoir exécutif (à deux têtes) et l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) l'initiative législative en donnant la priorité au premier.
On constate aujourd'hui des blocages divers et même un blocage institutionnel qui fait que le gouvernement présente des lois (qui émanent dans la plupart des cas de l'administration, pas des partis politiques) a l'assemblée qui en fait ce qu'elle veut et va même jusqu'à le réécrire complètement.
Exemple de blocage criant: Le projet de loi du Conseil supérieur de la magistrature, qui a duré des mois.
Aucun projet de réforme économique ou social majeur n'a encore eu lieu, une année après.
On a vu aussi récemment des réformes (et encore) passer sous la pression étrangère, ce qui est un très mauvais signal à donner.
Ce blocage est institutionnel et trouve ses origines dans la volonté de l'ARP de gouverner et de régenter la vie politique du pays et de dénier au gouvernement le droit d'engager sa responsabilité dans les projets de loi socio-économiques.
Notre Constitution est un mélange non réussi de partage des pouvoirs par la pratique.
Les blocs parlementaires des partis de la coalition gouvernementale comprennent que chaque projet de loi doit être "re-travaillé et ré-écrit" par l'assemblée.
La commission du consensus est un échec institutionnel en soi. Ceci engendre des bagarres, des délais et surtout un blocage institutionnel grave dont personne ne veut parler.
Le gouvernement ne défend ses projets de lois que timidement en l'absence d'une disposition constitutionnelle d'engagement de la responsabilité gouvernementale.
Le manque de leadership politique n'a pas permis de trouver les compromis nécessaires à un pays qui a besoin de se réformer en profondeur et vite.
3. Le rôle des partenaires sociaux.
Les partenaires sociaux ont un rôle politique à jouer. Bien entendu.
La défense des intérêts des travailleurs, des agriculteurs et des chômeurs est politique et le rôle des syndicats est primordial afin de rétablir un équilibre entre les différents acteurs économiques et sociaux.
Toutes les revendications sociales ont une incidence politique et donc séparer le politique du syndical est une hérésie.
Sauf qu'en l'absence d'un État fort, on constate une dérive pour revendiquer la co-gestion et même la gestion.
Plusieurs secteurs, plusieurs entreprises publiques et plusieurs régions sont des lieux de combats publics pour le pouvoir où les syndicats dépassent largement les prérogatives qui sont les leurs.
La non institutionnalisation du dialogue social en est une cause principale mais pas la seule.
La situation sociale est intenable par le niveau de précarité au delà de l'acceptable et qui touche plus des trois-quarts de la population et aussi par le niveau alarmant des inégalités dans le pays.
4. Des lobbies qui veulent toujours gouverner
Il ne faut pas tomber dans les simplifications et l'esprit complotiste mais il est clair que l'esprit corporatiste n'arrive pas à se hisser au niveau des aspirations d'un peuple qui veut le partage du "pouvoir symbolique".
La Tunisie comprend comme tous les pays - quoique d'une manière parfois très caricaturale - toutes les catégories des "gouvernants de l'ombre".
Cela va des faiseurs de rois, qui se croient toujours indispensables pour faire fonctionner la machine, qui se donnent de l'importance par la connivence de l'opportunisme ambiant aux détenteurs du pouvoir économique et financier, qui sont là aux aguets pour protéger leurs intérêts.
Cela concerne aussi les détenteurs du "pouvoir symbolique", des familles qui croient que leur sang bleu leur donne le statut de propriétaires d'un pays à protéger de la convoitise des locataires un peu trop nombreux à leurs yeux, aux différents corporatismes plus soucieux de protéger leurs privilèges que de se remettre en cause.
Enfin n'oublions pas, les "derniers puissants" devenus puissants par la seule grâce d'un État faible.
5. Un État défaillant et un leadership politique absent
Cet homme ne serait pas malade s'il n'était pas aussi faible.
On pourrait même dire que le pouvoir est à terre. Et les marques de la faiblesse de l'État ne font que grandir et irriter la grande majorité des citoyens soucieux de retrouver un tant soi peu cette tranquillité d'un État fort et qui fait appliquer la loi.
Or il n'est toujours pas aussi simple d'expliquer aux gens qu'un État fort est aussi un État juste.
Plusieurs raisons font que l'État est défaillant, et plusieurs raisons expliquent l'absence de leadership.
La principale étant la manière choisie de concevoir et d'appliquer la Constitution pour choisir un gouvernement de coalition qui in fine n'en est pas un.
La faiblesse des partis politiques et leur effritement sont la principale cause de ce manque de leadership politique, et on peut dire sans trop de risques que nous sommes revenus à une situation de déséquilibre politique similaire à 2011.
Depuis 2011, la Tunisie a été gérée grâce à un consensus politique plus ou moins large qui a évité aux pays certains écueils , ce qui est une partie positive dans le processus de transition démocratique et qui a mené à l'élaboration d'une Constitution globalement acceptée par tous.
Seulement, le pays ne peut plus être gouverné par le consensus car par définition il est mou puisque le dénominateur commun ne peut être que minimaliste.
Le pays ne pourra être gouverné que par le compromis entre les différentes forces agissantes et celles qui se disputent le pouvoir avec comme objectif majeur: Instaurer l'État.
Le compromis consiste à ce que chaque partie prenante fasse des concessions et obtienne quelque chose en retour.
Le garant de ce compromis à mon sens ne peut être que l'institution de la présidence de la République dans son rôle extra constitutionnel autour d'une table qui comprend les trois présidences, les présidents des partis de la coalition et les premiers responsables des organisations nationales majeures.
Les pistes de la sortie de crise existent et sont simples à mettre en œuvre dans un pays comme le notre, moyennant une classe politique renouvelée qui porte un projet national d'instauration d'un État démocratique, moderne et égalitaire et sa gouvernance nécessaire pour donner un nouvel espoir au pays et à ses jeunes.
Le reste, tout le reste suivra.
Retrouvez les articles du HuffPost Tunisie sur notre page Facebook.
-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.