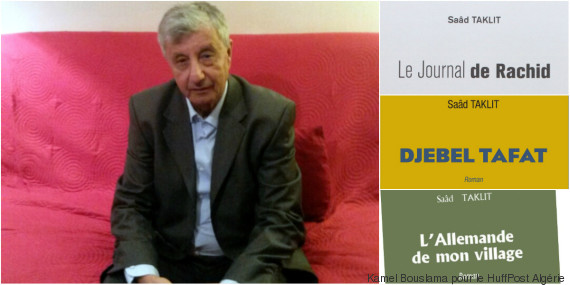
Voici une modeste contribution au débat, si pénible fût-il actuellement, sur le devoir de mémoire quant aux méfaits de la colonisation française dans notre pays : celui-ci (le devoir de mémoire) ne peut, en effet, s'opposer ni se substituer de façon axiomatique à l'Histoire. Néanmoins la mémoire collective, quand bien même elle ne peut tout remplacer, se légitime malgré tout dans la mesure où elle vise, entre autres finalités, à garantir l'identité d'un groupe, d'une communauté, d'une ethnie, voire de tout un peuple qui a un rapport affectif et douloureux au passé. Ici, trois romans phares de Saàd Taklit pour décrypter la colonisation dans notre pays et ses effets pervers post indépendance, parfois sur le sol mème de l'ancien colonisateur.
1- "Djebel Tafat", ou la Chronique d'un village sous la colonisation
(...) Pour situer et bien comprendre le contentieux durable entre les deux communautés algérienne et française depuis 1830, il faut ajouter à la violence militaire celle de la confiscation des terres, d'où résultèrent paupérisation et famines, en 1887, 1893, 1897, 1917, 1920, etc. D'un coté, le colonisateur réduisait la mortalité par une médecine moderne ; de l'autre, il créait la misère par la confiscation des terres et la surpopulation. Qui plus est, les autorités françaises n'ont jamais su définir l'identité juridique et politique de l'Algérie. Le mode d'être ensemble entre musulmans et Français n'a jamais été inventé, si ce n'est la domination.
C'est en se situant dans un tel contexte que le roman "Djebel Tafat", loin des mensonges et contre-vérités de l'idéologie officielle de l'ancien colonisateur, relate la chronique documentée de ce que vécurent les habitants d'un village de l'Algérie profonde, Bougaa (ex-Lafayette, Sétif, NDLR) pendant la période coloniale de 1830 à 1962. C'est, pour ainsi dire, l'histoire de la colonisation racontée, voire décryptée à travers l'histoire d'un village et tout particulièrement l'histoire d'une famille.
L'auteur avait six ans et demi quand éclata le premier coup de feu annonçant le début de la Guerre d'Indépendance, un des faits marquants bien connus de l'Histoire contemporaine, laissant dans son sillage du sang, des larmes et des douleurs qui ont marqué à jamais des générations entières.
Dans sa région montagneuse de Basse Kabylie, le 4e régiment de Dragons de l'armée française et les Katibas de l'ALN se livrent un combat sans merci durant toute la durée du conflit...
L'auteur présente les faits, les événements et les drames tels qu'il les a vécus, observés et sentis dans son âme d'adolescent. Ce sont là ses mémoires d'enfance et de jeunesse. La force du roman vient du désir profond et irrésistible de transmettre la mémoire dans un langage simple, avec des mots directs et sans nuances.
Il raconte...

Extrait du roman "Djebel Tafat"
(...) Un jour de l'année 1914, dans la rue principale du village, les passants se figent sur les trottoirs dans un silence religieux. Ils prêtent l'oreille aux nouvelles que vient annoncer le crieur public, qui n'est autre qu'Ahmed, le frère ainé de Da Amar. De grande taille et de forte corpulence, il porte au loin sa voix de ténor. Le circuit est tout tracé, en ligne droite : il prend le départ en face de la sous-préfecture et termine son trajet à la sortie ouest du village, devant le bâtiment de la gendarmerie. Pas un mètre de plus, pas un mètre de moins ! Le rituel de la diffusion des nouvelles commence par cette introduction, dans un cérémonial immuable :
-Oh ! Ecoutez celui qui vous annonce le bien et la paix ; Et la foule, à l'unisson, lui répond : "Bien et paix... ". Puis le crieur public, de sa voix grave, enchaine les nouvelles. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises, c'est selon. Cette fois-ci, elles ne sont pas réjouissantes, c'est un appel à la mobilisation générale : la Première Guerre mondiale vient de commencer...
La conscription est introduite en Algérie à partir de 1912. Mais, dans une première phase, seulement 8% du contingent indigène est concerné (1). Les colons ne voient pas d'un bon œil le fait que les Algériens soient formés à l'art de la guerre.
Plusieurs jeunes, à peine sortis de l'adolescence, partent pour le front, à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux. Pour certains, c'est la première fois qu'ils montent sur un camion. Leur horizon s'est toujours limité au sommet des montagnes qui entourent leur village. Même la ville de Sétif toute proche, que certains découvrent pour la première fois de leur vie, leur est inconnue.
Parmi ceux qui sont partis, certains ne reviendront jamais (2). Da Amar se souvient du départ du premier contingent, un lundi du mois de novembre 1914. Le ciel est bas, noir de nuages et il pleut des torrents. Les dizaines de conscrits qui ont répondu à l'appel sont issus, pour la plupart, du milieu rural. Parmi eux, des enfants du village. Les gens des autres douars se sont retrouvées, tôt le matin, sur la place de la salle des fêtes, lieu traditionnel de rassemblement. Les femmes pleurent. Certaines chantent des poèmes à la gloire de "Ma Tafat", suppliant Dieu tout puissant de ramener leurs fils sains et saufs de leur lointaine expédition, leurs bras levés aux cieux.
Parmi ceux de notre village qui ont survécu à l'horrible boucherie de la Grande Guerre figurent : Saci, Rezki et cheikh Djendi. Voici leur histoire : Saci est revenu de la guerre, décoré de la Croix de guerre. Les autres médailles qu'il a gagnées sur les champs de bataille sont arborées, non sans fierté, sur sa poitrine lors de la cérémonie de commémoration de l'armistice, le 11 novembre. C'est lui le porte-drapeau du groupe des Poilus de 14/18 qui, à chaque anniversaire, se recueillent devant le monument aux morts. C'est Rezki qui joue la sonnerie aux Morts en soufflant sur le vieux clairon qu'il a ramassé sur le champ de bataille, dans la Somme. Ce monument aux Morts, dédié aux victimes de la Grande Guerre, jouxte alors le café des Anciens Combattants.
Aujourd'hui, à cet endroit, s'élève une stèle commémorative de la Guerre d'indépendance où sont inscrits les noms des martyrs de la commune tombés au champ d'honneur pendant la Révolution. Quant au café des Anciens Combattants, il a été rebaptisé « Nadi (club) de moudjahidines »(...)
"Djebel Tafat", roman de Saàd Taklit, Editions L'Harmattan, Paris 2015, 300 pages. (1ère édition Dahleb, Alger 2012)
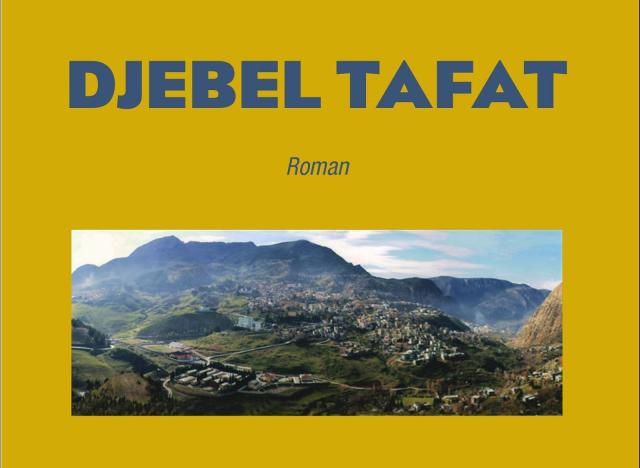
Notes :
(1): Ce "loyalisme" autochtone fut une heureuse surprise pour les responsables coloniaux. Seule la région des Aurès s'insurgea en 1916 contre l'incorporation des recrues. Le recrutement autochtone fournit 173.000 militaires don 87.000 engagés.
(2): 25.000 soldats musulmans sont tombés sur les champs de bataille durant la Première Guerre mondiale.
2- "Le journal de Rachid", ou les conséquences logiques postindépendance
Après "Djebel Tafat", chronique d'un village algérien durant la colonisation française, "Le journal de Rachid", du même auteur, s'inscrit comme une conséquence logique de cette colonisation à travers la présence, sur le sol français, d'une forte communauté algérienne émigrée.
Dans un style sobre et un texte limpide, qui confine à l'autobiographie, l'auteur, se basant entre autres vécus sur le sien propre, nous invite à une immersion dans la vie quotidienne d'une tranche de cette communauté émigrée laborieusement intégrée dans l'univers de plus en plus fermé d'une France en crise socioéconomique ; et partant, en crise de valeurs culturelles, voire humanistes.
Un tel contexte on ne peut plus difficile ne peut que présager des lendemains qui déchantent pour des personnages comme Rachid, auparavant cadre supérieur dans le pays d'origine mais qui, fuyant une existence affligeante de manques, de privations, de guerre larvée, finit par débarquer à son corps défendant et sur le tard en terre française, cherchant l'espoir et le rachat; mais qui se retrouve confronté à des acteurs d'une autre épopée de misère, de sacrifices, d'exploitation, d'incertitudes et souvent de désillusions tout aussi amères ; comme le terrible jour où, n'en pouvant plus de subir sarcasmes et coups tordus venant de ses vis-à-vis français, il décide de rendre le tablier en démissionnant de son emploi de médiateur dans "Bois Sacré", une association d'aide à l'emploi -entre autres aux émigrés- basée à Paris, dans le 18e arrondissement ...
C'est donc sous le signe de la "remémoration" -et parmi tant de pages sur la douloureuse expatriation de nombre de ses compatriotes- que l'auteur, campant le personnage de Rachid, voudrait placer son roman. En effet, se souvenir et raconter pour "ne pas oublier" signifie aussi, métaphoriquement, fouiller en soi et dans sa propre histoire, chercher l'étrange dans ce qui est familier : regarder, en somme, en profondeur et à distance. C'est, pour tout dire, à cela que nous invite toute littérature authentique comme celle de Saad Taklit ; et c'est ce que nous nous efforçons de faire grâce à la lecture de son roman, pour ne pas dire, par ailleurs et d'une manière générale, grâce à quelques précieux « éclats de lire » récoltés çà et là à travers nos pérégrinations littéraires.
Extrait du roman "Le journal de Rachid", Pages 164-165
(...) Les provocations se multiplient, les disputes entre collègues deviennent fréquentes. Je me sens vraiment rabaissé, dans cette atmosphère nauséabonde. je me sens ridicule, terriblement ridicule, à mon âge, de devoir subir encore les indignités dues aux agissements irresponsables d'Henriette.
Le temps où je représentais l'association aux comités de pilotages et autres réunions avec les entreprises partenaires, en l'absence de notre directeur, est bel et bien fini. En l'espace de quelques mois, le capital confiance s'est effrité, il a fondu comme beurre au soleil, par le bon vouloir d'Henriette.
Entretemps, Assia est partie. Comme il fallait s'y attendre, son contrat n'a pas été renouvelé. Henriette a également signifié à Fatima que son contrat ne sera pas reconduit non plus. Il ne reste plus que moi. je suis le dernier sur la liste, parce que j'ai un CDI.
Et puis, un matin du mois de mai 2009, je prends la résolution d'abandonner la partie. En l'absence de tout recours, je jette l'éponge. La pression est trop forte. Le pain est à ce prix là ? Non, trois fois non ! Je dois faire le choix entre préserver ma santé ou sombrer dans la dépression ; je choisis ma santé. Alors, je demande un départ à l'amiable.
Lorsque j'annonce ma décision à Henriette, son visage se met à rayonner de joie. Je peux voir, à travers son regard, l'expression de toute la haine qu'elle porte en elle. Une haine gratuite, innée j'allais dire, dont peut-être Henriette n'a même pas conscience. Au final, en moins de deux ans d'activité, elle peut se targuer d'avoir renvoyé qui à Pole Emploi, qui au RSA, cinq travailleurs sociaux, tous d'origine étrangère ! Curieux, n'est-ce pas ? Henriette a réussi son pari, elle peut s'enorgueillir de sa "victoire".
"Le journal de Rachid", de Saàd Taklit, Les Editions Baudelaire, Paris 2016, 186 p.
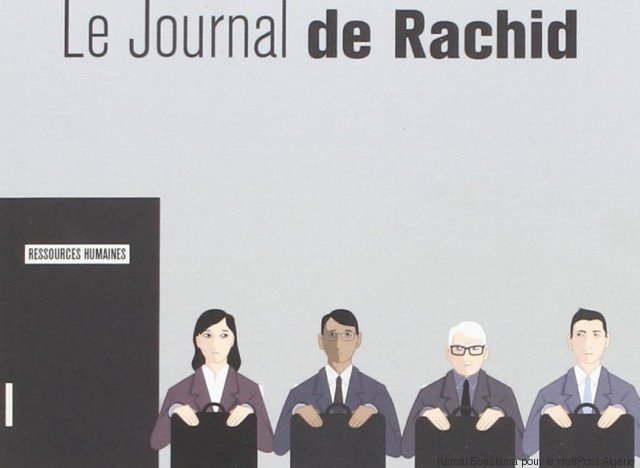
3- "L'Allemande de mon village", un bel hommage à titre posthume
A bien y regarder, rares sont les écrivains qui seront peut-ètre capables d'écrire un roman aussi ténu sur cette valeureuse Allemande -devenue "Saliha l'Algérienne"- comme vient de le faire récemment Saàd Taklit. Et ce, pour la bonne raison qu'on sait combien cet auteur, qui a déjà donné le "la" à travers ses deux premiers romans, "Djebel Tafat" et "Le journal de Rachid", ne faiblit pas lorsqu'il s'empare d'une histoire.
Avec Edith Ursula, cette Allemande que le destin a fait venir à Bougaa pour y vivre et en faire sa dernière demeure, autrement dit la photographe de métier dont il a épousé une des deux filles -qu'elle a eues avec son mari Abdallah Kahla-, il s'agissait d'y aller comme à une sorte de (re)découverte d'une Algérie villageoise dont nul, peut-ètre, n'a encore jusque-là raconté aussi bien la profondeur rurale et l'ingénuité paysanne à travers ce qu'était encore le Bougaa des années 1950.
Saàd Taklit n'a donc pas lésiné sur le parti à prendre : se mettre carrément à la place de son héroine, camper solidement son personnage et dérouler le "film" de son vécu algérien serti de dialogues sous-jacents ; un film vu depuis l'insondable énigme d'une jeune femme que l'on a pris plaisir à connaitre au fur et à mesure des pages parcourues, comme l'on connait les gens au mieux, d'abord par inadvertance, ensuite par petites touches répétitives faites de diverses tranches de vécus au village de jeunesse de l'auteur, devenu village adoptif d'e l'épouse Kahla.
Cela se produira avec bonheur, et c'est précisément le coté poignant de cette histoire à laquelle Saàd Taklit a apporté un peu plus que ses traditionnelles capacités de narrateur dans le genre romanesque : de la finesse dans le style, toujours une écriture au "fuseau", limpide et concise à la fois, évacuant toute formule alambiquée ou tournure sémantique savante, captant autant sinon plus qu'un stéthoscope : ce qui est bien la moindre des choses concernant le singulier destin d'une telle femme admise, adpotée, respectée et finalement aimée de tous les habitants du village de Bougaa dont elle a, pratiquement sans exception, fait le portrait dans son studio de photographie d'art.
Livre prenant au bout du compte, comme lorsqu'on tourne les pages d'un vieux roman d'aventures de jeunesse, réécrit néanmoins avec le recul spatio-temporel qui sied à de telles remémorations. Mais c'est toujours Edith Ursula qui entraine le livre, rarement l'inverse. Il y a là comme un défi posé à la littérature, un réel en soi, incarné par une seule figure irréductible à tout, au cliché, à l'anti-cliché, à l'enquète, à la projection fantasmatique. Pour tout dire, " l'Allemande de mon village" ou le sujet réincarné, mis au jour de souvenirs de jeunesse villageoise toujours aussi vivaces, est un roman captivant, car judicieusement enfanté par la plume talentueuse de Saàd Taklit.
Extrait du roman "L'Allemande de mon village"
La scène se déroule à Mayence, puis à Grunstadt (Allemagne), au lendemain de la seconde Guerre mondiale : "En ce jour de décembre 1945, emmitouflé dans un gros manteau, Abdallah se dirige vers la gare de Mayence, sous une pluie diluvienne. Dans une demi-heure, il doit prendre le train à destination de la ville de Grunstadt, distante d'une cinquantaine de kilomètres. En effet, il s'est fixé pour but de visiter les villages des alentours, au gré de sa fantaisie, lors de ses promenades du dimanche.
Il est impressionné par la propreté de la ville et par les centaines de pots de fleurs accrochés aux fenètres des maisons. En l'espace de quelques mois, la bourgade a retrouvé sa physionomie d'antan. Les traces laissées par la guerre ont pratiquement toutes disparu. Les Allemands se relèvent très vite (...). Entreprenants, ils font preuve d'un dynamisme remarquable. L'effort de reconstruction est colossal. Abdallah reste admiratif devant leur discipline (...)
Sur le chemin du retour, Il s'arrète un bon moment devant la vitrine d'un studio de photographie où sont exposés des portraits d'hommes et de femmes, ainsi qu'une ancienne photo de la ville, prise du ciel. Elle lui plait. Alors, il entre dans le studio et, du doigt, désigne la photo :
- Elle coùte combien ? Je l'achète, si vous me faites un prix. Je veux la garder en souvenir de votre ville. Une jolie fille, les yeux gris-vert, les cheveux chàtains clairs, lui répond avec un large sourire :
-Cette photo n'est pas à vendre, cher Monsieur, elle sert uniquement pour la décoration de la boutique. Je suis vraiment désolée. Abdallah est resté le regard fixé sur la jeune fille. Il la contemple avec des yeux attendris. La demoiselle, continue de sourire, attendant une réaction de son client...qui ne dit toujours rien ! Ses yeux sont toujours fixés sur elle. Alors, elle lui dit : -Monsieur désire peut-ètre autre chose ? -Non, merci. Je ne veux plus de la photo, j'ai changé d'avis ! Maintenant, c'est vous que je veux. Vous ètes très belle. Je voudrais faire votre connaissance (...).
"L'Allemande de mon village", roman de Saàd Taklit, Edition Dahleb, Alger 2016, 272 pages
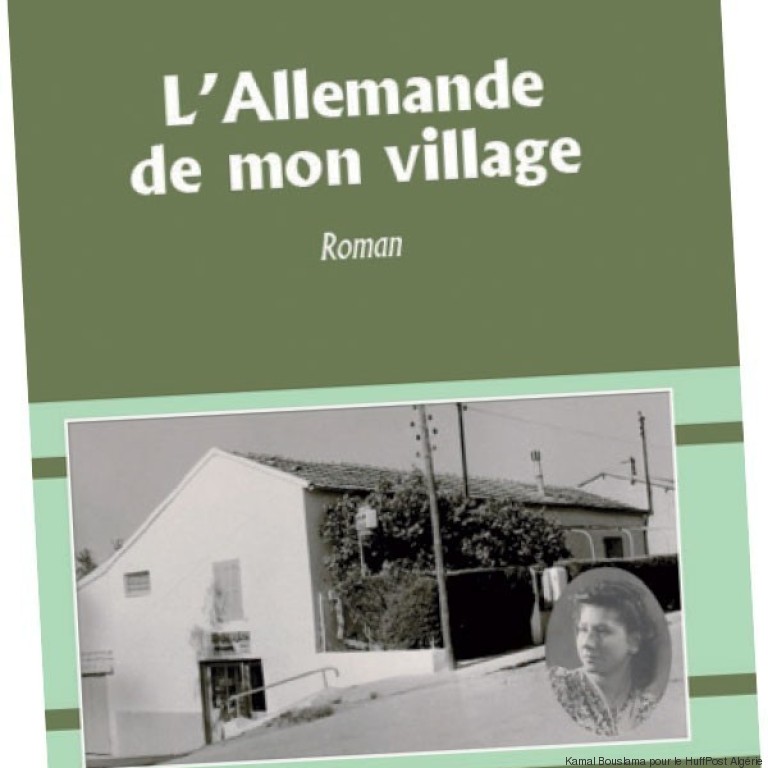
"L'Allemande de mon village": le texte de la quatrième de couverture
"Une histoire vraie. L'histoire d'une femme et d'un homme que rien ne prédisposait à se retrouver unis pour la vie. Lui, indigène algérien (c'est ainsi que l'on nommait les Algériens au temps de l'Algérie française) engagé volontaire aux cotés des forces françaises pendant la seconde Guerre mondiale. Elle, une Allemande, photographe, originaire de la Saxe. Son père est maitre porcelainier, sculpteur à ses heures de loisir. Sa mère est décoratrice.
Un jour, leurs regards se croisent. Ils ne se quitteront plus. Leur rencontre est inscrite dans leurs destinées. Lui dira que c'est le "mektoub", elle, dira que c'est le destin. Mais au fond, les deux termes ne signifient-ils pas la mème chose ? Le jeune homme s'appelle abdallah. Alors qu'il était adolescent, une diseuse de bonne aventure, une Noire du Grang Sud, lui aurait prédit une rencontre avec une femme venant d'un pays du Nord, où il fait froid toute l'année...Pour sa part, la jeune fille qui porte le nom d'Edith Ursula avait fait un rève...Et c'est dans son pays d'adoption, l'Algérie, le pays qu'elle a tant aimé, qu'elle rendra son dernier souffle, le matin du 2 mars 1991.
Pourtant, à l'époque, elle ignorait tout de ce pays qui était si mystérieux à ses yeux. Elle avait toujours le sourire aux lèvres...Un jour, un vieux devin lui avait donné le nom de Saliha, qui veut dire vertueuse en arabe. Elle le portera jusqu'à sa mort. Aujourd'hui, deux arbres ont poussé sur sa tombe, c'est tout ce qu'elle avait demandé dans son agonie ...".

A SUIVRE: ENTRETIEN AVEC SAAD TAKLIT
Retrouvez les articles de HuffPost Algérie sur notre page Facebook.
Pour suivre les dernières actualités en direct, cliquez ici.
-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our terms. It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website.